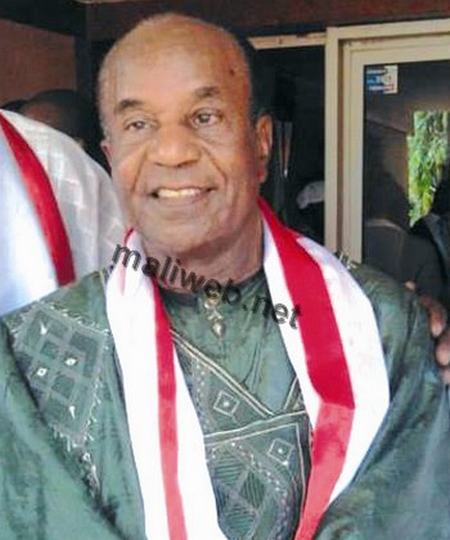[caption id="attachment_1146742" align="alignright" width="310"]

Mohamed Amara[/caption]
Comment vous est venue l’idée d’écrire ?
Début 2012, le septentrion a été attaqué, et en mars, la junte militaire a renversé le président ATT. Immédiatement, j’ai ressenti le besoin d’analyser les causes profondes qui pouvaient expliquer l’effondrement de ce que le monde entier appelait la démocratie malienne. Après le coup d’Etat du 22 mars, l’expression démocratie de façade a fleuri sur toutes les lèvres. Notre démocratie s’était arrêtée aux urnes. Nous avions confié notre pays à des illusionnistes. Dans mon livre, j’explique comment nous, Maliennes et Maliens, avons participé à cette illusion de démocratie, et j’y propose, au fur et à mesure, des solutions pour qu’ensemble, nous puissions créer un Mali, paisible, laïc et digne.
Quelles failles essentielles avez-vous relevées ?
La première est la carence diplomatique de notre pays. En janvier et février 2012, j’ai été stupéfait de constater qu’aucune autorité de mon pays n’était capable de contrecarrer les séparatistes qui justifiaient leurs revendications en falsifiant les réalités socio-démographiques du septentrion. Notre incompétence diplomatique a provoqué une immense incompréhension, une grande frustration chez les gens restés au Nord. Quand les 3 régions ont été entièrement occupées, les gens se sont sentis abandonnés et trahis. Cela a engendré «le chacun pour soi et Dieu pour tous» et donc beaucoup de tensions intercommunautaires. Aujourd’hui encore, la plupart des diplomates maliens méconnaissent les réalités du Nord. Ils ne peuvent pas contribuer à la résolution de cette crise qui perdure. La diplomatie est un métier, il faut y être formé. Le Mali ne peut plus se permettre de nommer n’importe qui à ces postes stratégiques. La deuxième est notre amour du consensus. Nous aimons dire «asseyons nous pour trouver la solution». Nous nous berçons d’illusions, car le consensus atteint est toujours mou. Ce n’est qu’un accord de façade. Nous ne remettons jamais en question ce sur quoi nous nous mettons d’accord. C’est ce qui a contribué à mener notre pays dans le gouffre. C’est ce qui permet au conflit de perdurer. Il faut que les causes du conflit soient discutées et qu’on arrive à un compromis, pas à un consensus. Nous, Maliens, ne sommes pas capables de nous remettre en cause. Quand quelque chose ne va pas, nous cherchons à désigner un coupable. Sans être naïf quant à la France et la Minusma, depuis plusieurs mois, je constate que nous les désignons comme seuls responsables de nos maux. Alors que nous devrions chercher ce qui, dans notre propre fonctionnement sociétal, contribue à l’impasse dans laquelle nous sommes. En tant que Maliens, nous remettre en cause, c’est un peu «perdre notre virilité», c’est-à-dire, porter atteinte à notre fierté. Nous ne supportons pas d’être critiqués, et n’aimons pas nous autocritiquer. Dans notre système scolaire, nous ne recevons aucune formation dans ce domaine. Nous discutons beaucoup entre nous, mais ce ne sont que des discussions de «grin» qui n’entraînent aucun changement fondamental.
Vous soulevez aussi la question de la corruption…
En effet, la corruption gangrène notre système depuis des décennies. Au Mali, tout le monde est corrompu et corruptible. Nous prétendons tous vouloir y mettre fin, mais personne n’est prêt à changer son propre fonctionnement. Au sommet, nos cadres sont des amateurs, incapables de stopper ce fléau. Ils ne savent pas dire non. Ils ont perdu la notion de ce qu’ils peuvent faire, s’interdire de faire et laisser faire. Tant que nos cadres ne seront pas formés au civisme, notre pays ne se développera pas. Notre système scolaire aussi est corrompu. Dès le plus jeune âge, nos enfants apprennent à «se débrouiller». Notre pays ne peut pas évoluer ainsi. Il faut que nous acceptions la sanction. Des organismes indépendants doivent être créés pour contrôler les pratiques dans tous les domaines, les institutions publiques, les hôpitaux, l’école, partout. Après le premier avertissement, celui qui a dérivé doit être sanctionné immédiatement. Notre société ne pourra jamais fonctionner si nous cherchons toujours à échapper à la justice.
Expliquez-nous le poids du «social» ?
Parmi nos fonctionnements, il y en a un qui est tout aussi dévastateur que ce que je viens de citer. C’est ce que nous appelons le social. Ce social pèse très lourd, mais personne n’en parle. Dans notre culture, l’aîné, ou celui qui a réussi, peut avoir à sa charge les cinquante personnes de sa grande famille. Tout le monde attend beaucoup de lui, il subit de nombreuses pressions. Pour y faire face financièrement, beaucoup ne peuvent pas faire autrement que de franchir certaines limites. Les parents ferment tous les yeux. Personne ne critique les pratiques douteuses puisque tout le monde en profite. Celui qui le ferait serait d’ailleurs immédiatement sanctionné socialement. Un pays n’eut pas émergé si les citoyens ne se remettent pas en cause.
Comment faire évoluer cet héritage socio-culturel ?
L’évolution viendrait d’elle-même si la situation économique des individus s’améliorait. Si tous les gens en âge de travailler gagnaient correctement leur vie, chacun pourrait s’assumer financièrement. Il n’exercerait plus de pression sur quiconque. Les mauvaises pratiques disparaîtraient spontanément. Il ne s’agit pas de vouloir faire disparaître la solidarité si chère à nos cœurs, elle prendrait une autre forme. Si tout le monde avait un emploi, chacun cotiserait proportionnellement à son salaire à des caisses de financement de la santé et du chômage temporaire. Nous devons aller vers une mutualisation citoyenne des moyens pour que la charge ne repose plus sur un seul individu par la grande famille. Si tout le monde avait un emploi, chacun paierait des impôts. S’il y avait une vraie volonté politique et surtout une bonne gestion des deniers publics, l’Etat moderniserait le pays, il n’y aurait plus de problèmes d’accès à l’eau, à l’électricité, et des infrastructures seraient construites et entretenues partout. Je reconnais que cela fait beaucoup de si.
Comment expliquez-vous qu’une société aussi respectueuse des principes religieux soit gangrénée par la corruption ?
L’immense majorité des croyants ignorent les fondamentaux de leur religion. Ils n’ont pas réellement conscience que certaines pratiques ne sont pas acceptables, car elles font partie du quotidien depuis trop longtemps. Les leaders religieux doivent être des pédagogues, montrer l’exemple, et surtout rester à l’écart du domaine politique. Nous, Maliennes, Maliens, devons réapprendre à dire, non je ne veux pas faire ça car je ne me reconnais pas dans ces pratiques, peu importe notre religion, ou notre origine culturelle.
La réforme en profondeur de la société prendra beaucoup de temps, n’est-ce pas ?
Oui, ce sera long, probablement une cinquantaine d’années. Vous parlez de réforme, je dirais plutôt une révolution. Pas une révolution par les armes, non. Une révolution où, nous, Maliennes, Maliens, nous mettrons ensemble pour modifier définitivement notre fonctionnement. Nous devons être prêts à nous sacrifier tous ensemble d’un commun accord, afin que nos enfants aient une autre vie que la nôtre. Cette révolution ne pourra avoir lieu que si nous avons un leader qui se mettra au-dessus de la mêlée et travaillera pour le bien-être de toutes les populations. Il nous faut un leader qui nous conduira à ce Mali rêvé. Malheureusement, pour le moment, je ne crois pas qu’un tel leader existe au Mali. Il nous faut quelqu’un de neuf, et chez nous, tout est fait pour que les jeunes n’émergent pas. Au Mali, on prend les mêmes, et on recommence, donc rien ne peut changer.
Ce jeune leader malien existe-t-il à l’extérieur ?
Certainement, car au sein de la diaspora, il y a énormément de compétences. Le changement dont nous rêvons tous ne serait possible que si une ou un de ces jeunes très bien formés prenait les rênes du pays. Ceux qui vivent au Mali dépendent souvent de leurs parents à l’extérieur. Ils ont confiance en eux. Ils connaissent les qualités professionnelles de la seconde génération. Si un jour, un de ces jeunes leur présentait pédagogiquement un programme socio-économique solide pour réformer le pays, ils n’hésiteraient pas à voter pour lui.
Je vous laisse conclure.
Lorsque j’ai écrit ce livre, je ne voulais pas parler des groupes armés ou du coup d’Etat. Je voulais souligner les problèmes profondément ancrés dans notre société qui ont fait le lit de ces crises, et surtout proposer des solutions pour que, à terme, le Mali se porte bien. Je voulais expliquer le big-bang à l’origine de cette crise et lancer ce message au pays tout entier : acceptez d’être Maliens, et de participer à la stabilité de notre Etat pour le bien commun.
Propos recueillis par Françoise WASSERVOGEL  Mohamed Amara[/caption]
Comment vous est venue l’idée d’écrire ?
Début 2012, le septentrion a été attaqué, et en mars, la junte militaire a renversé le président ATT. Immédiatement, j’ai ressenti le besoin d’analyser les causes profondes qui pouvaient expliquer l’effondrement de ce que le monde entier appelait la démocratie malienne. Après le coup d’Etat du 22 mars, l’expression démocratie de façade a fleuri sur toutes les lèvres. Notre démocratie s’était arrêtée aux urnes. Nous avions confié notre pays à des illusionnistes. Dans mon livre, j’explique comment nous, Maliennes et Maliens, avons participé à cette illusion de démocratie, et j’y propose, au fur et à mesure, des solutions pour qu’ensemble, nous puissions créer un Mali, paisible, laïc et digne.
Quelles failles essentielles avez-vous relevées ?
La première est la carence diplomatique de notre pays. En janvier et février 2012, j’ai été stupéfait de constater qu’aucune autorité de mon pays n’était capable de contrecarrer les séparatistes qui justifiaient leurs revendications en falsifiant les réalités socio-démographiques du septentrion. Notre incompétence diplomatique a provoqué une immense incompréhension, une grande frustration chez les gens restés au Nord. Quand les 3 régions ont été entièrement occupées, les gens se sont sentis abandonnés et trahis. Cela a engendré «le chacun pour soi et Dieu pour tous» et donc beaucoup de tensions intercommunautaires. Aujourd’hui encore, la plupart des diplomates maliens méconnaissent les réalités du Nord. Ils ne peuvent pas contribuer à la résolution de cette crise qui perdure. La diplomatie est un métier, il faut y être formé. Le Mali ne peut plus se permettre de nommer n’importe qui à ces postes stratégiques. La deuxième est notre amour du consensus. Nous aimons dire «asseyons nous pour trouver la solution». Nous nous berçons d’illusions, car le consensus atteint est toujours mou. Ce n’est qu’un accord de façade. Nous ne remettons jamais en question ce sur quoi nous nous mettons d’accord. C’est ce qui a contribué à mener notre pays dans le gouffre. C’est ce qui permet au conflit de perdurer. Il faut que les causes du conflit soient discutées et qu’on arrive à un compromis, pas à un consensus. Nous, Maliens, ne sommes pas capables de nous remettre en cause. Quand quelque chose ne va pas, nous cherchons à désigner un coupable. Sans être naïf quant à la France et la Minusma, depuis plusieurs mois, je constate que nous les désignons comme seuls responsables de nos maux. Alors que nous devrions chercher ce qui, dans notre propre fonctionnement sociétal, contribue à l’impasse dans laquelle nous sommes. En tant que Maliens, nous remettre en cause, c’est un peu «perdre notre virilité», c’est-à-dire, porter atteinte à notre fierté. Nous ne supportons pas d’être critiqués, et n’aimons pas nous autocritiquer. Dans notre système scolaire, nous ne recevons aucune formation dans ce domaine. Nous discutons beaucoup entre nous, mais ce ne sont que des discussions de «grin» qui n’entraînent aucun changement fondamental.
Vous soulevez aussi la question de la corruption…
En effet, la corruption gangrène notre système depuis des décennies. Au Mali, tout le monde est corrompu et corruptible. Nous prétendons tous vouloir y mettre fin, mais personne n’est prêt à changer son propre fonctionnement. Au sommet, nos cadres sont des amateurs, incapables de stopper ce fléau. Ils ne savent pas dire non. Ils ont perdu la notion de ce qu’ils peuvent faire, s’interdire de faire et laisser faire. Tant que nos cadres ne seront pas formés au civisme, notre pays ne se développera pas. Notre système scolaire aussi est corrompu. Dès le plus jeune âge, nos enfants apprennent à «se débrouiller». Notre pays ne peut pas évoluer ainsi. Il faut que nous acceptions la sanction. Des organismes indépendants doivent être créés pour contrôler les pratiques dans tous les domaines, les institutions publiques, les hôpitaux, l’école, partout. Après le premier avertissement, celui qui a dérivé doit être sanctionné immédiatement. Notre société ne pourra jamais fonctionner si nous cherchons toujours à échapper à la justice.
Expliquez-nous le poids du «social» ?
Parmi nos fonctionnements, il y en a un qui est tout aussi dévastateur que ce que je viens de citer. C’est ce que nous appelons le social. Ce social pèse très lourd, mais personne n’en parle. Dans notre culture, l’aîné, ou celui qui a réussi, peut avoir à sa charge les cinquante personnes de sa grande famille. Tout le monde attend beaucoup de lui, il subit de nombreuses pressions. Pour y faire face financièrement, beaucoup ne peuvent pas faire autrement que de franchir certaines limites. Les parents ferment tous les yeux. Personne ne critique les pratiques douteuses puisque tout le monde en profite. Celui qui le ferait serait d’ailleurs immédiatement sanctionné socialement. Un pays n’eut pas émergé si les citoyens ne se remettent pas en cause.
Comment faire évoluer cet héritage socio-culturel ?
L’évolution viendrait d’elle-même si la situation économique des individus s’améliorait. Si tous les gens en âge de travailler gagnaient correctement leur vie, chacun pourrait s’assumer financièrement. Il n’exercerait plus de pression sur quiconque. Les mauvaises pratiques disparaîtraient spontanément. Il ne s’agit pas de vouloir faire disparaître la solidarité si chère à nos cœurs, elle prendrait une autre forme. Si tout le monde avait un emploi, chacun cotiserait proportionnellement à son salaire à des caisses de financement de la santé et du chômage temporaire. Nous devons aller vers une mutualisation citoyenne des moyens pour que la charge ne repose plus sur un seul individu par la grande famille. Si tout le monde avait un emploi, chacun paierait des impôts. S’il y avait une vraie volonté politique et surtout une bonne gestion des deniers publics, l’Etat moderniserait le pays, il n’y aurait plus de problèmes d’accès à l’eau, à l’électricité, et des infrastructures seraient construites et entretenues partout. Je reconnais que cela fait beaucoup de si.
Comment expliquez-vous qu’une société aussi respectueuse des principes religieux soit gangrénée par la corruption ?
L’immense majorité des croyants ignorent les fondamentaux de leur religion. Ils n’ont pas réellement conscience que certaines pratiques ne sont pas acceptables, car elles font partie du quotidien depuis trop longtemps. Les leaders religieux doivent être des pédagogues, montrer l’exemple, et surtout rester à l’écart du domaine politique. Nous, Maliennes, Maliens, devons réapprendre à dire, non je ne veux pas faire ça car je ne me reconnais pas dans ces pratiques, peu importe notre religion, ou notre origine culturelle.
La réforme en profondeur de la société prendra beaucoup de temps, n’est-ce pas ?
Oui, ce sera long, probablement une cinquantaine d’années. Vous parlez de réforme, je dirais plutôt une révolution. Pas une révolution par les armes, non. Une révolution où, nous, Maliennes, Maliens, nous mettrons ensemble pour modifier définitivement notre fonctionnement. Nous devons être prêts à nous sacrifier tous ensemble d’un commun accord, afin que nos enfants aient une autre vie que la nôtre. Cette révolution ne pourra avoir lieu que si nous avons un leader qui se mettra au-dessus de la mêlée et travaillera pour le bien-être de toutes les populations. Il nous faut un leader qui nous conduira à ce Mali rêvé. Malheureusement, pour le moment, je ne crois pas qu’un tel leader existe au Mali. Il nous faut quelqu’un de neuf, et chez nous, tout est fait pour que les jeunes n’émergent pas. Au Mali, on prend les mêmes, et on recommence, donc rien ne peut changer.
Ce jeune leader malien existe-t-il à l’extérieur ?
Certainement, car au sein de la diaspora, il y a énormément de compétences. Le changement dont nous rêvons tous ne serait possible que si une ou un de ces jeunes très bien formés prenait les rênes du pays. Ceux qui vivent au Mali dépendent souvent de leurs parents à l’extérieur. Ils ont confiance en eux. Ils connaissent les qualités professionnelles de la seconde génération. Si un jour, un de ces jeunes leur présentait pédagogiquement un programme socio-économique solide pour réformer le pays, ils n’hésiteraient pas à voter pour lui.
Je vous laisse conclure.
Lorsque j’ai écrit ce livre, je ne voulais pas parler des groupes armés ou du coup d’Etat. Je voulais souligner les problèmes profondément ancrés dans notre société qui ont fait le lit de ces crises, et surtout proposer des solutions pour que, à terme, le Mali se porte bien. Je voulais expliquer le big-bang à l’origine de cette crise et lancer ce message au pays tout entier : acceptez d’être Maliens, et de participer à la stabilité de notre Etat pour le bien commun.
Propos recueillis par Françoise WASSERVOGEL
Mohamed Amara[/caption]
Comment vous est venue l’idée d’écrire ?
Début 2012, le septentrion a été attaqué, et en mars, la junte militaire a renversé le président ATT. Immédiatement, j’ai ressenti le besoin d’analyser les causes profondes qui pouvaient expliquer l’effondrement de ce que le monde entier appelait la démocratie malienne. Après le coup d’Etat du 22 mars, l’expression démocratie de façade a fleuri sur toutes les lèvres. Notre démocratie s’était arrêtée aux urnes. Nous avions confié notre pays à des illusionnistes. Dans mon livre, j’explique comment nous, Maliennes et Maliens, avons participé à cette illusion de démocratie, et j’y propose, au fur et à mesure, des solutions pour qu’ensemble, nous puissions créer un Mali, paisible, laïc et digne.
Quelles failles essentielles avez-vous relevées ?
La première est la carence diplomatique de notre pays. En janvier et février 2012, j’ai été stupéfait de constater qu’aucune autorité de mon pays n’était capable de contrecarrer les séparatistes qui justifiaient leurs revendications en falsifiant les réalités socio-démographiques du septentrion. Notre incompétence diplomatique a provoqué une immense incompréhension, une grande frustration chez les gens restés au Nord. Quand les 3 régions ont été entièrement occupées, les gens se sont sentis abandonnés et trahis. Cela a engendré «le chacun pour soi et Dieu pour tous» et donc beaucoup de tensions intercommunautaires. Aujourd’hui encore, la plupart des diplomates maliens méconnaissent les réalités du Nord. Ils ne peuvent pas contribuer à la résolution de cette crise qui perdure. La diplomatie est un métier, il faut y être formé. Le Mali ne peut plus se permettre de nommer n’importe qui à ces postes stratégiques. La deuxième est notre amour du consensus. Nous aimons dire «asseyons nous pour trouver la solution». Nous nous berçons d’illusions, car le consensus atteint est toujours mou. Ce n’est qu’un accord de façade. Nous ne remettons jamais en question ce sur quoi nous nous mettons d’accord. C’est ce qui a contribué à mener notre pays dans le gouffre. C’est ce qui permet au conflit de perdurer. Il faut que les causes du conflit soient discutées et qu’on arrive à un compromis, pas à un consensus. Nous, Maliens, ne sommes pas capables de nous remettre en cause. Quand quelque chose ne va pas, nous cherchons à désigner un coupable. Sans être naïf quant à la France et la Minusma, depuis plusieurs mois, je constate que nous les désignons comme seuls responsables de nos maux. Alors que nous devrions chercher ce qui, dans notre propre fonctionnement sociétal, contribue à l’impasse dans laquelle nous sommes. En tant que Maliens, nous remettre en cause, c’est un peu «perdre notre virilité», c’est-à-dire, porter atteinte à notre fierté. Nous ne supportons pas d’être critiqués, et n’aimons pas nous autocritiquer. Dans notre système scolaire, nous ne recevons aucune formation dans ce domaine. Nous discutons beaucoup entre nous, mais ce ne sont que des discussions de «grin» qui n’entraînent aucun changement fondamental.
Vous soulevez aussi la question de la corruption…
En effet, la corruption gangrène notre système depuis des décennies. Au Mali, tout le monde est corrompu et corruptible. Nous prétendons tous vouloir y mettre fin, mais personne n’est prêt à changer son propre fonctionnement. Au sommet, nos cadres sont des amateurs, incapables de stopper ce fléau. Ils ne savent pas dire non. Ils ont perdu la notion de ce qu’ils peuvent faire, s’interdire de faire et laisser faire. Tant que nos cadres ne seront pas formés au civisme, notre pays ne se développera pas. Notre système scolaire aussi est corrompu. Dès le plus jeune âge, nos enfants apprennent à «se débrouiller». Notre pays ne peut pas évoluer ainsi. Il faut que nous acceptions la sanction. Des organismes indépendants doivent être créés pour contrôler les pratiques dans tous les domaines, les institutions publiques, les hôpitaux, l’école, partout. Après le premier avertissement, celui qui a dérivé doit être sanctionné immédiatement. Notre société ne pourra jamais fonctionner si nous cherchons toujours à échapper à la justice.
Expliquez-nous le poids du «social» ?
Parmi nos fonctionnements, il y en a un qui est tout aussi dévastateur que ce que je viens de citer. C’est ce que nous appelons le social. Ce social pèse très lourd, mais personne n’en parle. Dans notre culture, l’aîné, ou celui qui a réussi, peut avoir à sa charge les cinquante personnes de sa grande famille. Tout le monde attend beaucoup de lui, il subit de nombreuses pressions. Pour y faire face financièrement, beaucoup ne peuvent pas faire autrement que de franchir certaines limites. Les parents ferment tous les yeux. Personne ne critique les pratiques douteuses puisque tout le monde en profite. Celui qui le ferait serait d’ailleurs immédiatement sanctionné socialement. Un pays n’eut pas émergé si les citoyens ne se remettent pas en cause.
Comment faire évoluer cet héritage socio-culturel ?
L’évolution viendrait d’elle-même si la situation économique des individus s’améliorait. Si tous les gens en âge de travailler gagnaient correctement leur vie, chacun pourrait s’assumer financièrement. Il n’exercerait plus de pression sur quiconque. Les mauvaises pratiques disparaîtraient spontanément. Il ne s’agit pas de vouloir faire disparaître la solidarité si chère à nos cœurs, elle prendrait une autre forme. Si tout le monde avait un emploi, chacun cotiserait proportionnellement à son salaire à des caisses de financement de la santé et du chômage temporaire. Nous devons aller vers une mutualisation citoyenne des moyens pour que la charge ne repose plus sur un seul individu par la grande famille. Si tout le monde avait un emploi, chacun paierait des impôts. S’il y avait une vraie volonté politique et surtout une bonne gestion des deniers publics, l’Etat moderniserait le pays, il n’y aurait plus de problèmes d’accès à l’eau, à l’électricité, et des infrastructures seraient construites et entretenues partout. Je reconnais que cela fait beaucoup de si.
Comment expliquez-vous qu’une société aussi respectueuse des principes religieux soit gangrénée par la corruption ?
L’immense majorité des croyants ignorent les fondamentaux de leur religion. Ils n’ont pas réellement conscience que certaines pratiques ne sont pas acceptables, car elles font partie du quotidien depuis trop longtemps. Les leaders religieux doivent être des pédagogues, montrer l’exemple, et surtout rester à l’écart du domaine politique. Nous, Maliennes, Maliens, devons réapprendre à dire, non je ne veux pas faire ça car je ne me reconnais pas dans ces pratiques, peu importe notre religion, ou notre origine culturelle.
La réforme en profondeur de la société prendra beaucoup de temps, n’est-ce pas ?
Oui, ce sera long, probablement une cinquantaine d’années. Vous parlez de réforme, je dirais plutôt une révolution. Pas une révolution par les armes, non. Une révolution où, nous, Maliennes, Maliens, nous mettrons ensemble pour modifier définitivement notre fonctionnement. Nous devons être prêts à nous sacrifier tous ensemble d’un commun accord, afin que nos enfants aient une autre vie que la nôtre. Cette révolution ne pourra avoir lieu que si nous avons un leader qui se mettra au-dessus de la mêlée et travaillera pour le bien-être de toutes les populations. Il nous faut un leader qui nous conduira à ce Mali rêvé. Malheureusement, pour le moment, je ne crois pas qu’un tel leader existe au Mali. Il nous faut quelqu’un de neuf, et chez nous, tout est fait pour que les jeunes n’émergent pas. Au Mali, on prend les mêmes, et on recommence, donc rien ne peut changer.
Ce jeune leader malien existe-t-il à l’extérieur ?
Certainement, car au sein de la diaspora, il y a énormément de compétences. Le changement dont nous rêvons tous ne serait possible que si une ou un de ces jeunes très bien formés prenait les rênes du pays. Ceux qui vivent au Mali dépendent souvent de leurs parents à l’extérieur. Ils ont confiance en eux. Ils connaissent les qualités professionnelles de la seconde génération. Si un jour, un de ces jeunes leur présentait pédagogiquement un programme socio-économique solide pour réformer le pays, ils n’hésiteraient pas à voter pour lui.
Je vous laisse conclure.
Lorsque j’ai écrit ce livre, je ne voulais pas parler des groupes armés ou du coup d’Etat. Je voulais souligner les problèmes profondément ancrés dans notre société qui ont fait le lit de ces crises, et surtout proposer des solutions pour que, à terme, le Mali se porte bien. Je voulais expliquer le big-bang à l’origine de cette crise et lancer ce message au pays tout entier : acceptez d’être Maliens, et de participer à la stabilité de notre Etat pour le bien commun.
Propos recueillis par Françoise WASSERVOGEL