La mondialisation est une forme moderne de perpétuation de l’inégalité économique. Pourtant, ce concept a bien un but : garder les pays pauvres comme sources d’approvisionnement en biens et ressources ; ce qui permettrait aux pays riches de conserver leur niveau de vie. Les pays africains, le Mali en particulier, sont de véritables « perroquets » qui répètent mécaniquement les mêmes arguments qui prévalent en Occident.
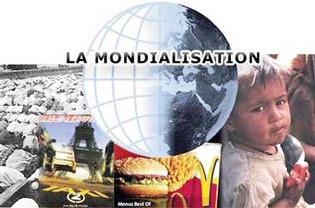
Il faut rendre la mondialisation humaine et aider les pays pauvres à y faire face. Autrement dit, les durs et pénibles travaux à faible valeur ajoutée et impraticable en Occident seront faits dans le Tiers Monde. Ainsi, les appareils électroniques qui coûtaient 300 dollars US en 1980 reviennent toujours au même prix en 2012 lorsqu’il s’agit de les vendre en Afrique. Et puisque l’Afrique n’a toujours pas un plan cohérent de développement économique et d’indépendance, elle continuera à être un « réservoir » de consommation ou seront déversés tous les produits fabriqués dans le monde. Cependant, l’indépendance signifie d’abord un certain degré d’autonomie. Mais lorsqu’on considère des pays comme le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad et la Centrafrique, qui importent de l’étranger presque la moitié, soit les 50% de leur propre nourriture, on comprend très aisément combien un simple embargo militaire sur les livraisons de biens et services suffirait à les asphyxier tout en les anéantissant sur tous les plans. L’exemple malien est même patent : ses devises essentiellement dans l’exportation de ses ressources minières (or), l’or blanc (coton) et quelques céréales (riz) de l’Office du Niger. Il est bien dommage que le pauvre Mali n’ait autre chose à apporter sur le marché commun que ces deux produits d’ailleurs épuisables (pour l’or et le coton) et dont la production suffit à peine à la consommation locale.
Il faut qu’un jour, les Africains, surtout les Maliens aient « la force de l’union de l’analyse et surtout de l’anticipation ». L’histoire ne nous enseigne-elle pas que « la coexistence entre les peuples a toujours été et sera toujours un rapport de force » ? Le jour où l’Afrique, le Mali en particulier, aura son arme nucléaire, comme la Chine ou l’Inde, le Mali pourra se consacrer tranquillement à développer l’agropastorale qui est le domaine de prédilection, voire la vocation même d’un pays sahélien par excellence. Il faut donc organiser et diligenter l’agriculture pour la rendre plus productive dans toutes ses composantes et initier ensuite un début d’industrialisation par des industries agroalimentaires. Il y a également lieu de sélectionner nos dirigeants en choisissant les meilleurs, les plus patriotes et dévoués à la cause de leur patrie : rien que le Mali et seulement le Mali ! C’est à ce moment qu’on comprendra alors que « le respect s’obtient par l’intelligence et la force ». Aux Africains, il faut une nouvelle manière de voir le monde et ses enjeux en prenant en compte les ressources énergétiques (le pétrole) surtout en adoptant ensuite une stratégie de défense assez adéquate pour éradiquer une fois pour toutes les rebellions intempestives de nos jours en vogue pour déstabiliser les démocraties africaines, et enfin pour prendre au sérieux la problématique de la mondialisation qui a bipolarisé le monde en un groupe de pays non productifs dits « pauvres », mais pourvoyeurs de matières premières et consommateurs de produits finis pour d’autres pays dits «riches » qui s’enrichissent en apportant à ce marché mondial tout ce dont il a besoin en qualité, bien sûr au détriment des produits venant du Sud. Du coup, nous assistons à une mondialisation à sens unique d’un seul maître à penser : l’Occident.
Cette manière africaine de voir le monde doit tenir compte des intérêts de l’Afrique. « Avant que les ministères africains des Affaires étrangères ne fassent des analyses sur la marche du monde, ils feraient mieux d’en faire d’abord pour notre propre intérêt », conclut un analyste.
Abdoulaye Faman Coulibaly
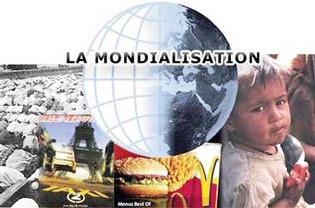 Il faut rendre la mondialisation humaine et aider les pays pauvres à y faire face. Autrement dit, les durs et pénibles travaux à faible valeur ajoutée et impraticable en Occident seront faits dans le Tiers Monde. Ainsi, les appareils électroniques qui coûtaient 300 dollars US en 1980 reviennent toujours au même prix en 2012 lorsqu’il s’agit de les vendre en Afrique. Et puisque l’Afrique n’a toujours pas un plan cohérent de développement économique et d’indépendance, elle continuera à être un « réservoir » de consommation ou seront déversés tous les produits fabriqués dans le monde. Cependant, l’indépendance signifie d’abord un certain degré d’autonomie. Mais lorsqu’on considère des pays comme le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad et la Centrafrique, qui importent de l’étranger presque la moitié, soit les 50% de leur propre nourriture, on comprend très aisément combien un simple embargo militaire sur les livraisons de biens et services suffirait à les asphyxier tout en les anéantissant sur tous les plans. L’exemple malien est même patent : ses devises essentiellement dans l’exportation de ses ressources minières (or), l’or blanc (coton) et quelques céréales (riz) de l’Office du Niger. Il est bien dommage que le pauvre Mali n’ait autre chose à apporter sur le marché commun que ces deux produits d’ailleurs épuisables (pour l’or et le coton) et dont la production suffit à peine à la consommation locale.
Il faut qu’un jour, les Africains, surtout les Maliens aient « la force de l’union de l’analyse et surtout de l’anticipation ». L’histoire ne nous enseigne-elle pas que « la coexistence entre les peuples a toujours été et sera toujours un rapport de force » ? Le jour où l’Afrique, le Mali en particulier, aura son arme nucléaire, comme la Chine ou l’Inde, le Mali pourra se consacrer tranquillement à développer l’agropastorale qui est le domaine de prédilection, voire la vocation même d’un pays sahélien par excellence. Il faut donc organiser et diligenter l’agriculture pour la rendre plus productive dans toutes ses composantes et initier ensuite un début d’industrialisation par des industries agroalimentaires. Il y a également lieu de sélectionner nos dirigeants en choisissant les meilleurs, les plus patriotes et dévoués à la cause de leur patrie : rien que le Mali et seulement le Mali ! C’est à ce moment qu’on comprendra alors que « le respect s’obtient par l’intelligence et la force ». Aux Africains, il faut une nouvelle manière de voir le monde et ses enjeux en prenant en compte les ressources énergétiques (le pétrole) surtout en adoptant ensuite une stratégie de défense assez adéquate pour éradiquer une fois pour toutes les rebellions intempestives de nos jours en vogue pour déstabiliser les démocraties africaines, et enfin pour prendre au sérieux la problématique de la mondialisation qui a bipolarisé le monde en un groupe de pays non productifs dits « pauvres », mais pourvoyeurs de matières premières et consommateurs de produits finis pour d’autres pays dits «riches » qui s’enrichissent en apportant à ce marché mondial tout ce dont il a besoin en qualité, bien sûr au détriment des produits venant du Sud. Du coup, nous assistons à une mondialisation à sens unique d’un seul maître à penser : l’Occident.
Cette manière africaine de voir le monde doit tenir compte des intérêts de l’Afrique. « Avant que les ministères africains des Affaires étrangères ne fassent des analyses sur la marche du monde, ils feraient mieux d’en faire d’abord pour notre propre intérêt », conclut un analyste.
Abdoulaye Faman Coulibaly
Il faut rendre la mondialisation humaine et aider les pays pauvres à y faire face. Autrement dit, les durs et pénibles travaux à faible valeur ajoutée et impraticable en Occident seront faits dans le Tiers Monde. Ainsi, les appareils électroniques qui coûtaient 300 dollars US en 1980 reviennent toujours au même prix en 2012 lorsqu’il s’agit de les vendre en Afrique. Et puisque l’Afrique n’a toujours pas un plan cohérent de développement économique et d’indépendance, elle continuera à être un « réservoir » de consommation ou seront déversés tous les produits fabriqués dans le monde. Cependant, l’indépendance signifie d’abord un certain degré d’autonomie. Mais lorsqu’on considère des pays comme le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad et la Centrafrique, qui importent de l’étranger presque la moitié, soit les 50% de leur propre nourriture, on comprend très aisément combien un simple embargo militaire sur les livraisons de biens et services suffirait à les asphyxier tout en les anéantissant sur tous les plans. L’exemple malien est même patent : ses devises essentiellement dans l’exportation de ses ressources minières (or), l’or blanc (coton) et quelques céréales (riz) de l’Office du Niger. Il est bien dommage que le pauvre Mali n’ait autre chose à apporter sur le marché commun que ces deux produits d’ailleurs épuisables (pour l’or et le coton) et dont la production suffit à peine à la consommation locale.
Il faut qu’un jour, les Africains, surtout les Maliens aient « la force de l’union de l’analyse et surtout de l’anticipation ». L’histoire ne nous enseigne-elle pas que « la coexistence entre les peuples a toujours été et sera toujours un rapport de force » ? Le jour où l’Afrique, le Mali en particulier, aura son arme nucléaire, comme la Chine ou l’Inde, le Mali pourra se consacrer tranquillement à développer l’agropastorale qui est le domaine de prédilection, voire la vocation même d’un pays sahélien par excellence. Il faut donc organiser et diligenter l’agriculture pour la rendre plus productive dans toutes ses composantes et initier ensuite un début d’industrialisation par des industries agroalimentaires. Il y a également lieu de sélectionner nos dirigeants en choisissant les meilleurs, les plus patriotes et dévoués à la cause de leur patrie : rien que le Mali et seulement le Mali ! C’est à ce moment qu’on comprendra alors que « le respect s’obtient par l’intelligence et la force ». Aux Africains, il faut une nouvelle manière de voir le monde et ses enjeux en prenant en compte les ressources énergétiques (le pétrole) surtout en adoptant ensuite une stratégie de défense assez adéquate pour éradiquer une fois pour toutes les rebellions intempestives de nos jours en vogue pour déstabiliser les démocraties africaines, et enfin pour prendre au sérieux la problématique de la mondialisation qui a bipolarisé le monde en un groupe de pays non productifs dits « pauvres », mais pourvoyeurs de matières premières et consommateurs de produits finis pour d’autres pays dits «riches » qui s’enrichissent en apportant à ce marché mondial tout ce dont il a besoin en qualité, bien sûr au détriment des produits venant du Sud. Du coup, nous assistons à une mondialisation à sens unique d’un seul maître à penser : l’Occident.
Cette manière africaine de voir le monde doit tenir compte des intérêts de l’Afrique. « Avant que les ministères africains des Affaires étrangères ne fassent des analyses sur la marche du monde, ils feraient mieux d’en faire d’abord pour notre propre intérêt », conclut un analyste.
Abdoulaye Faman Coulibaly 












































