Le Pacte National et les Accords d’Alger, sont des blessures pour la majorité des Maliens. Pourtant, Il s’agit d’une œuvre collective, dont nul homme politique ayant participé à la gestion du Mali, ces 20 dernières années ne saurait s’exonérer. D’ailleurs tous les Maliens ont accepté le Pacte National par souci de préserver la paix et les Accords d’Alger n’en sont que la résultante. Les contestataires d’aujourd’hui sont les acteurs d’hier. Le courage politique ou civique aujourd’hui ne consiste pas à se distancier, mais à assumer, corriger et construire la paix demain.
[caption id="attachment_48982" align="alignleft" width="300" caption="Madani Tall"]
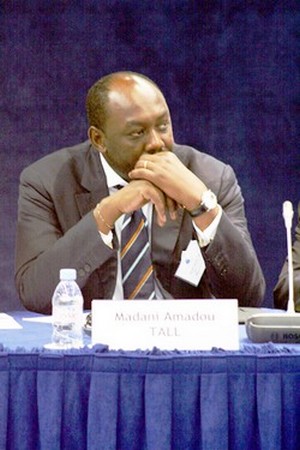
[/caption]
Nous connaissons tous les insuffisances de notre pays dans la gestion des rébellions depuis 1963. Nous savons également que faute d’accepter que l’appartenance ethnique importe peu, certains de nos frères, victimes inconscientes de leurs propres passions, ne penseront qu’à une éternelle révolte qui sera toujours sans issue en raison de l’insécabilité du Mali, et ne fera que semer les germes de plus de violence, de vengeance et de douleur. Et au lieu de pointer du doigt, les Maliens doivent rester soudés pour l’avenir de notre démocratie.
Pourtant mon propos ici n’est pas redire ce qui n’a pas été fait, mais appeler au sens de la responsabilité de tous, dans la gestion de cette crise.
En effet, jusqu’à il y a quelques mois, le Mali, bien que considéré comme un petit pays très pauvre et très endetté menait tout de même son bout de chemin. Le bilan de 20 années de démocratie était globalement positif et cette dernière décade avait permis de mettre en place les infrastructures du développement, avec charge pour notre génération de reconstruire l’école, assurer l’emploi et innover pour créer une richesse mieux redistribuée. Nous étions un havre de stabilité dans un environnement globalement délétère.
Le développement bien que n’ayant pas tenu toutes ses promesses suivait son chemin et la rébellion était maitrisée et réduite à un groupuscule d’irréductibles sans moyens réels de menacer la stabilité du Mali.
Mais la guerre que l’OTAN a menée en Libye a changé la donne. La chute de kadhafi a permis à des déserteurs de l’armée Libyenne de pénétrer sur notre sol, lourdement armée, financièrement préparés et décidés à se tailler un royaume dans un pays souverain.
Il est essentiel dans ce contexte que le sens de la responsabilité et de la solidarité conduisent des partenaires comme la France à reconnaitre le dommage collatéral mais combien préjudiciable que l’intervention en Libye a causé au Mali. Cela malgré les griefs que d’aucuns ne manqueront d’apposer au Mali. Car pour le maintien de la stabilité de la bande sahélienne le maintien des équilibres au Mali est fondamentale.
Cela est renforcé par le fait que le Mali, la Mauritanie et l’Algérie partagent la majeure partie de ce territoire que revendique les présumés sécessionnistes. Pourtant d’aucuns accusent la Mauritanie d’être le lieu de ravitaillement et le repos des assaillants, allant jusqu’à citer Fassala comme leur base arrière. Cela est inamical et intolérable si tel est le cas, et tranche avec la volonté des dirigeants mauritaniens à abandonner les coups de force au profit de la démocratie, et en cela le Mali n’a jamais été le maillon faible.
Ni ingérence, ni indifférence. Cela n’implique pas laisser un pays ami payer les effets de nos actions en observateur neutre. Cela ne peut qu’entretenir le sentiment que beaucoup de Maliens et d’Africains ont sur la sélectivité de l’esprit humaniste que prône la patrie des Droits de l’Homme.
Nombre de pays ont soutenu, même tardivement, les printemps arabes. Mais on ne saurait faire de la révolte un nouveau dogme, car elle n’a de valeur que lorsqu’elle exprime le sentiment du peuple. Or, non seulement les assaillants du Mali ne représentent pas le peuple, mais ne représentent pas les populations septentrionales du Mali. Accorder une légitimité à leurs exactions ne fera qu’exacerber les tensions inter-ethniques. Le Mali n’a pas besoin de cela, ne le mérite pas et ne peut non plus accepter qu’un chantage sordide pèse sur le devenir de notre démocratie.
Passe que la fascination des hommes bleus conduise quelque indulgence. Passe que des séparatistes soient reçus pour mieux cerner leurs desseins, mais aujourd’hui chacun sait que leurs revendications sont insoutenables, comme chacun sait que ce sont des Libyens qui forment l’ossature de cette cohorte. Se poser en médiateur ne suffit plus à un moment où il s’agit de condamner sans réserve une insurrection lâche.
La communauté internationale a condamné les talibans parce que toute révolte armée n’est pas légitime. La Corse qui pourtant était italienne jusqu’en 1768, appartient légitimement à la France et l’irrédentisme insulaire n’y changera rien. Il est alors difficilement concevable de croire que des territoires qui ont toujours été le Mali, puissent faire l’objet de quelques revendications que cela soit. Aujourd’hui ce sont les urnes qui déterminent qui détient ou pas la légitimité politique. Insérer le critère ethnique dans une démocratie en construction ne peut que conduire à des lendemains difficiles.
Les revendications actuelles ne diffèrent en rien de celles de l’ETA qui veut une scission l’Espagne et la France pour créer un État Basque. De même que Nouméa ne peut prétendre aux autoroutes d’Ile de France, il est difficile pour un pays au stade du Mali de satisfaire chaque revendication. Devons nous fractionner la Belgique, revenir à l’époque de Bruce qui voulait son Écosse ? A quoi a servi la désintégration de la Yougoslavie et les guerres fratricides et horribles en résultant, si c’est pour ensuite vouloir construire ensemble l’Europe ? Pourtant nous avons vu la force du peuple Rwandais qui malgré tant de souffrance a pu maintenir son unité.
Chacun doit également percevoir qu’il est improbable que la connivence entre AQMI, les rebelles et autres salafistes soit nulle. C’est une erreur de croire que ces vendeurs d’illusions sont solvables, qu’ils peuvent sécuriser la zone, libérer les otages et tenir les engagements pris. En cela, il ne doit pas être tabou de d’envisager que même les Etats puissants commettent des erreurs d’appréciation sans que cela fasse l’objet de représailles. Une fois la réalité cernée, il convient de corriger ce qui doit l’être.
Notre démocratie est menacée par un ennemi qui nous est étranger, aujourd’hui plus que jamais, le Mali a besoin de ses amis et de l’union de tous les Maliens de bonne volonté. Comme le soutenait un grand politologue du «Noveccento», la neutralité n’est pas une position optimale. Il soutenait également qu’en cas de conflit, il fallait rallier la position du plus faible. Dans ce cas précis c’est en direction du peuple Malien qu’il faut regarder, au delà de tout autre calcul.
Une chose est sûre c’est que les Maliens ne comprennent pas l’apparente inertie de nos partenaires qui ne peuvent que difficilement dissocier la crise Libyenne de la crise Malienne. Comme disent les américains «il faut finir le job» car ceux qui étaient pourchassés en Libye sont maintenant au Mali. Ils doivent rentrer dans l’ordre républicain.
Entretemps, nous Maliens ne devons tolérer aucune altération du processus démocratique que le peuple a initié en 1992, car les générations futures ne retiendront pas les anecdotes, mais nous tiendront collectivement responsables de notre échec face à un ennemi qui ne souhaite que nous désunir pour mieux nous atteindre.
Madani Amadou Tall, Président de l’ADM
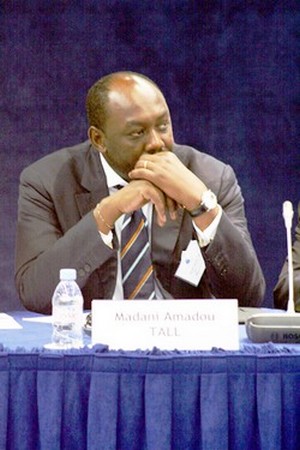 [/caption]
Nous connaissons tous les insuffisances de notre pays dans la gestion des rébellions depuis 1963. Nous savons également que faute d’accepter que l’appartenance ethnique importe peu, certains de nos frères, victimes inconscientes de leurs propres passions, ne penseront qu’à une éternelle révolte qui sera toujours sans issue en raison de l’insécabilité du Mali, et ne fera que semer les germes de plus de violence, de vengeance et de douleur. Et au lieu de pointer du doigt, les Maliens doivent rester soudés pour l’avenir de notre démocratie.
Pourtant mon propos ici n’est pas redire ce qui n’a pas été fait, mais appeler au sens de la responsabilité de tous, dans la gestion de cette crise.
En effet, jusqu’à il y a quelques mois, le Mali, bien que considéré comme un petit pays très pauvre et très endetté menait tout de même son bout de chemin. Le bilan de 20 années de démocratie était globalement positif et cette dernière décade avait permis de mettre en place les infrastructures du développement, avec charge pour notre génération de reconstruire l’école, assurer l’emploi et innover pour créer une richesse mieux redistribuée. Nous étions un havre de stabilité dans un environnement globalement délétère.
Le développement bien que n’ayant pas tenu toutes ses promesses suivait son chemin et la rébellion était maitrisée et réduite à un groupuscule d’irréductibles sans moyens réels de menacer la stabilité du Mali.
Mais la guerre que l’OTAN a menée en Libye a changé la donne. La chute de kadhafi a permis à des déserteurs de l’armée Libyenne de pénétrer sur notre sol, lourdement armée, financièrement préparés et décidés à se tailler un royaume dans un pays souverain.
Il est essentiel dans ce contexte que le sens de la responsabilité et de la solidarité conduisent des partenaires comme la France à reconnaitre le dommage collatéral mais combien préjudiciable que l’intervention en Libye a causé au Mali. Cela malgré les griefs que d’aucuns ne manqueront d’apposer au Mali. Car pour le maintien de la stabilité de la bande sahélienne le maintien des équilibres au Mali est fondamentale.
Cela est renforcé par le fait que le Mali, la Mauritanie et l’Algérie partagent la majeure partie de ce territoire que revendique les présumés sécessionnistes. Pourtant d’aucuns accusent la Mauritanie d’être le lieu de ravitaillement et le repos des assaillants, allant jusqu’à citer Fassala comme leur base arrière. Cela est inamical et intolérable si tel est le cas, et tranche avec la volonté des dirigeants mauritaniens à abandonner les coups de force au profit de la démocratie, et en cela le Mali n’a jamais été le maillon faible.
Ni ingérence, ni indifférence. Cela n’implique pas laisser un pays ami payer les effets de nos actions en observateur neutre. Cela ne peut qu’entretenir le sentiment que beaucoup de Maliens et d’Africains ont sur la sélectivité de l’esprit humaniste que prône la patrie des Droits de l’Homme.
Nombre de pays ont soutenu, même tardivement, les printemps arabes. Mais on ne saurait faire de la révolte un nouveau dogme, car elle n’a de valeur que lorsqu’elle exprime le sentiment du peuple. Or, non seulement les assaillants du Mali ne représentent pas le peuple, mais ne représentent pas les populations septentrionales du Mali. Accorder une légitimité à leurs exactions ne fera qu’exacerber les tensions inter-ethniques. Le Mali n’a pas besoin de cela, ne le mérite pas et ne peut non plus accepter qu’un chantage sordide pèse sur le devenir de notre démocratie.
Passe que la fascination des hommes bleus conduise quelque indulgence. Passe que des séparatistes soient reçus pour mieux cerner leurs desseins, mais aujourd’hui chacun sait que leurs revendications sont insoutenables, comme chacun sait que ce sont des Libyens qui forment l’ossature de cette cohorte. Se poser en médiateur ne suffit plus à un moment où il s’agit de condamner sans réserve une insurrection lâche.
La communauté internationale a condamné les talibans parce que toute révolte armée n’est pas légitime. La Corse qui pourtant était italienne jusqu’en 1768, appartient légitimement à la France et l’irrédentisme insulaire n’y changera rien. Il est alors difficilement concevable de croire que des territoires qui ont toujours été le Mali, puissent faire l’objet de quelques revendications que cela soit. Aujourd’hui ce sont les urnes qui déterminent qui détient ou pas la légitimité politique. Insérer le critère ethnique dans une démocratie en construction ne peut que conduire à des lendemains difficiles.
Les revendications actuelles ne diffèrent en rien de celles de l’ETA qui veut une scission l’Espagne et la France pour créer un État Basque. De même que Nouméa ne peut prétendre aux autoroutes d’Ile de France, il est difficile pour un pays au stade du Mali de satisfaire chaque revendication. Devons nous fractionner la Belgique, revenir à l’époque de Bruce qui voulait son Écosse ? A quoi a servi la désintégration de la Yougoslavie et les guerres fratricides et horribles en résultant, si c’est pour ensuite vouloir construire ensemble l’Europe ? Pourtant nous avons vu la force du peuple Rwandais qui malgré tant de souffrance a pu maintenir son unité.
Chacun doit également percevoir qu’il est improbable que la connivence entre AQMI, les rebelles et autres salafistes soit nulle. C’est une erreur de croire que ces vendeurs d’illusions sont solvables, qu’ils peuvent sécuriser la zone, libérer les otages et tenir les engagements pris. En cela, il ne doit pas être tabou de d’envisager que même les Etats puissants commettent des erreurs d’appréciation sans que cela fasse l’objet de représailles. Une fois la réalité cernée, il convient de corriger ce qui doit l’être.
Notre démocratie est menacée par un ennemi qui nous est étranger, aujourd’hui plus que jamais, le Mali a besoin de ses amis et de l’union de tous les Maliens de bonne volonté. Comme le soutenait un grand politologue du «Noveccento», la neutralité n’est pas une position optimale. Il soutenait également qu’en cas de conflit, il fallait rallier la position du plus faible. Dans ce cas précis c’est en direction du peuple Malien qu’il faut regarder, au delà de tout autre calcul.
Une chose est sûre c’est que les Maliens ne comprennent pas l’apparente inertie de nos partenaires qui ne peuvent que difficilement dissocier la crise Libyenne de la crise Malienne. Comme disent les américains «il faut finir le job» car ceux qui étaient pourchassés en Libye sont maintenant au Mali. Ils doivent rentrer dans l’ordre républicain.
Entretemps, nous Maliens ne devons tolérer aucune altération du processus démocratique que le peuple a initié en 1992, car les générations futures ne retiendront pas les anecdotes, mais nous tiendront collectivement responsables de notre échec face à un ennemi qui ne souhaite que nous désunir pour mieux nous atteindre.
Madani Amadou Tall, Président de l’ADM
[/caption]
Nous connaissons tous les insuffisances de notre pays dans la gestion des rébellions depuis 1963. Nous savons également que faute d’accepter que l’appartenance ethnique importe peu, certains de nos frères, victimes inconscientes de leurs propres passions, ne penseront qu’à une éternelle révolte qui sera toujours sans issue en raison de l’insécabilité du Mali, et ne fera que semer les germes de plus de violence, de vengeance et de douleur. Et au lieu de pointer du doigt, les Maliens doivent rester soudés pour l’avenir de notre démocratie.
Pourtant mon propos ici n’est pas redire ce qui n’a pas été fait, mais appeler au sens de la responsabilité de tous, dans la gestion de cette crise.
En effet, jusqu’à il y a quelques mois, le Mali, bien que considéré comme un petit pays très pauvre et très endetté menait tout de même son bout de chemin. Le bilan de 20 années de démocratie était globalement positif et cette dernière décade avait permis de mettre en place les infrastructures du développement, avec charge pour notre génération de reconstruire l’école, assurer l’emploi et innover pour créer une richesse mieux redistribuée. Nous étions un havre de stabilité dans un environnement globalement délétère.
Le développement bien que n’ayant pas tenu toutes ses promesses suivait son chemin et la rébellion était maitrisée et réduite à un groupuscule d’irréductibles sans moyens réels de menacer la stabilité du Mali.
Mais la guerre que l’OTAN a menée en Libye a changé la donne. La chute de kadhafi a permis à des déserteurs de l’armée Libyenne de pénétrer sur notre sol, lourdement armée, financièrement préparés et décidés à se tailler un royaume dans un pays souverain.
Il est essentiel dans ce contexte que le sens de la responsabilité et de la solidarité conduisent des partenaires comme la France à reconnaitre le dommage collatéral mais combien préjudiciable que l’intervention en Libye a causé au Mali. Cela malgré les griefs que d’aucuns ne manqueront d’apposer au Mali. Car pour le maintien de la stabilité de la bande sahélienne le maintien des équilibres au Mali est fondamentale.
Cela est renforcé par le fait que le Mali, la Mauritanie et l’Algérie partagent la majeure partie de ce territoire que revendique les présumés sécessionnistes. Pourtant d’aucuns accusent la Mauritanie d’être le lieu de ravitaillement et le repos des assaillants, allant jusqu’à citer Fassala comme leur base arrière. Cela est inamical et intolérable si tel est le cas, et tranche avec la volonté des dirigeants mauritaniens à abandonner les coups de force au profit de la démocratie, et en cela le Mali n’a jamais été le maillon faible.
Ni ingérence, ni indifférence. Cela n’implique pas laisser un pays ami payer les effets de nos actions en observateur neutre. Cela ne peut qu’entretenir le sentiment que beaucoup de Maliens et d’Africains ont sur la sélectivité de l’esprit humaniste que prône la patrie des Droits de l’Homme.
Nombre de pays ont soutenu, même tardivement, les printemps arabes. Mais on ne saurait faire de la révolte un nouveau dogme, car elle n’a de valeur que lorsqu’elle exprime le sentiment du peuple. Or, non seulement les assaillants du Mali ne représentent pas le peuple, mais ne représentent pas les populations septentrionales du Mali. Accorder une légitimité à leurs exactions ne fera qu’exacerber les tensions inter-ethniques. Le Mali n’a pas besoin de cela, ne le mérite pas et ne peut non plus accepter qu’un chantage sordide pèse sur le devenir de notre démocratie.
Passe que la fascination des hommes bleus conduise quelque indulgence. Passe que des séparatistes soient reçus pour mieux cerner leurs desseins, mais aujourd’hui chacun sait que leurs revendications sont insoutenables, comme chacun sait que ce sont des Libyens qui forment l’ossature de cette cohorte. Se poser en médiateur ne suffit plus à un moment où il s’agit de condamner sans réserve une insurrection lâche.
La communauté internationale a condamné les talibans parce que toute révolte armée n’est pas légitime. La Corse qui pourtant était italienne jusqu’en 1768, appartient légitimement à la France et l’irrédentisme insulaire n’y changera rien. Il est alors difficilement concevable de croire que des territoires qui ont toujours été le Mali, puissent faire l’objet de quelques revendications que cela soit. Aujourd’hui ce sont les urnes qui déterminent qui détient ou pas la légitimité politique. Insérer le critère ethnique dans une démocratie en construction ne peut que conduire à des lendemains difficiles.
Les revendications actuelles ne diffèrent en rien de celles de l’ETA qui veut une scission l’Espagne et la France pour créer un État Basque. De même que Nouméa ne peut prétendre aux autoroutes d’Ile de France, il est difficile pour un pays au stade du Mali de satisfaire chaque revendication. Devons nous fractionner la Belgique, revenir à l’époque de Bruce qui voulait son Écosse ? A quoi a servi la désintégration de la Yougoslavie et les guerres fratricides et horribles en résultant, si c’est pour ensuite vouloir construire ensemble l’Europe ? Pourtant nous avons vu la force du peuple Rwandais qui malgré tant de souffrance a pu maintenir son unité.
Chacun doit également percevoir qu’il est improbable que la connivence entre AQMI, les rebelles et autres salafistes soit nulle. C’est une erreur de croire que ces vendeurs d’illusions sont solvables, qu’ils peuvent sécuriser la zone, libérer les otages et tenir les engagements pris. En cela, il ne doit pas être tabou de d’envisager que même les Etats puissants commettent des erreurs d’appréciation sans que cela fasse l’objet de représailles. Une fois la réalité cernée, il convient de corriger ce qui doit l’être.
Notre démocratie est menacée par un ennemi qui nous est étranger, aujourd’hui plus que jamais, le Mali a besoin de ses amis et de l’union de tous les Maliens de bonne volonté. Comme le soutenait un grand politologue du «Noveccento», la neutralité n’est pas une position optimale. Il soutenait également qu’en cas de conflit, il fallait rallier la position du plus faible. Dans ce cas précis c’est en direction du peuple Malien qu’il faut regarder, au delà de tout autre calcul.
Une chose est sûre c’est que les Maliens ne comprennent pas l’apparente inertie de nos partenaires qui ne peuvent que difficilement dissocier la crise Libyenne de la crise Malienne. Comme disent les américains «il faut finir le job» car ceux qui étaient pourchassés en Libye sont maintenant au Mali. Ils doivent rentrer dans l’ordre républicain.
Entretemps, nous Maliens ne devons tolérer aucune altération du processus démocratique que le peuple a initié en 1992, car les générations futures ne retiendront pas les anecdotes, mais nous tiendront collectivement responsables de notre échec face à un ennemi qui ne souhaite que nous désunir pour mieux nous atteindre.
Madani Amadou Tall, Président de l’ADM 












































